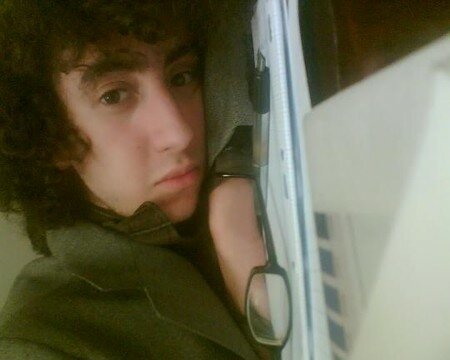Il
y'a ces couloirs longs, qui ne se doutent de rien. Le décor
n'est pas à la hauteur, le décor ne se colle pas à
ma peau. Le train ne va pas assez vite, le train s'arrête, me
nargue, les gens ne me regardent pas, le sens n'est pas à sa
place. A l'intérieur, je visite mon impatience. Regardez-moi,
je pars, j'arrive. Je vais la chercher. Silencieuse comme un jour de
février, sous la pluie.
L'instant
est calme. Ses yeux sont grands, ils étouffent une peur qui
bat dans les poumons, ils encerclent un sourire timide qui tremble
sous la langue, ils ouvrent grand les paupières comme une
bouche pour engloutir votre corps qui arrive, pressé,
souterrain, poli. Et vous, et vous, et vous, bien sur, bien sur, tout
doit s'accélérer,
les mots, ici, là bas, les mots d'autrefois, de ces jours là,
bien sur, vous, qu'attendez-vous, les mots mouillés par un
regard inconnu, défaits par un sourire silencieux. Bien sur,
vous attendez, que les mots trahissent. Non, rien, j'ai croisé
mon ombre. Stop. Seulement les trajets sont lourds,
seulement les trajets peuvent décrire, ensuite, je suis
incapable, je suis l'impuissant, je suis celui qui descend dans le
lac, qui ouvre la bouche dans l'eau, qui s'étouffe avec son
sel. Ensuite, je
suis incapable,
les mots ne vont pas assez vite. Bien sur. Je suis incapable de dire,
la surface d'un rire, des cheveux solides sur un visage plat,
incapable de lui prendre la main, de la regarder sans penser. Sans
penser que. Par la fenêtre, elle imagine, des mots, des
phrases, des littératures oubliées, qu'elle imagine.
Pourquoi. Je suis incapable, bien sur, vous, vous attendez, mais je
suis incapable.
Il
y'a eu cette scène :
la
chambre est seule, la chambre est serrée. Je la reconnais, je
ne la connais pas, mais je la reconnais, je la rencontre. Il y'a le
bois, sage, et les photos accrochées avec empressement, les
photos impatientes, les photos immobiles qui traversent les murs. Il
y'a une armoire en bois, fermée, qui semble n'avoir jamais été
ouverte, l'armoire interdite, l'armoire du désordre. Dans ma
tête, c'est l'armoire qu'on n'approche pas. C'est ça.
Maman disait que. Elle avait raison. Il me fallait des interdits. Ca
sera l'armoire, et ça sera sa main. Sa main droite posée
à côté de moi, comme un animal apeurée,
fraîche et nouvelle. J'imagine sa nuque endormie sur
l'oreiller, je ne la vois pas, mes cheveux cachent mes yeux, je ne
vois pas sa nuque, sa peau, mon visage est penchée, je ne vois
qu'une main. Une main qui n'est pas une main. Une main déguisée
en main. Une main qui ressemble à une attente. J'imagine
l'odeur, j'imagine la moiteur. Je ne vois rien, je ne sens rien. Il
y'a mes pieds qui se frottent, l'un contre l'autre, à l'autre
bout du lit, ma peau qui se détache, mes pieds gorgés
d'eau de la douche, d'eau parfumée, mon tee-shirt qui se
soulève au dessus du bassin, une langue silencieuse portée
entre deux lèvres. Il y'a une main et un corps que je ne vois
pas. Je ne me retourne pas. Et commencer. Commencer le travail.
Commencer le travail, du désamour. Retenir, tout retenir.
Cette scène, où je dois tout retenir. L'odeur, la forme
de l'armoire, la couleur des draps, le trouble du plafond, le silence
de son sommeil. Ne rien oublier. Retenir, la nuit derrière la
vitre, qui nous regarde, qui me questionne. Je me bouche les
oreilles. Tais-toi. Vite, s'approcher de tout. S'approcher du départ,
de la main, de la lune, du miroir fleuris, des bougies éteintes,
des dentelles qui essaient de deviner. Taisez-vous. Je voudrais que
les éléments se taisent. Je suis dans mon action. Je
suis dans l'émotion brouillée. Il y'a cette scène
donc, et cette fille, en face, cette actrice, qui remonte sa robe,
qui empreinte les traces, de la nudité. De ma nudité,
que j'ai oubliée, en venant ici. Je ne parlerai pas, je ne
bougerai pas, je ne me déshabillerai pas, je ne pleurerai pas,
je serai mélangée. Je serai poli. Il y'a cette scène,
de ma première insolence : tout retenir, pour m'oublier.
Et
puis, il y'a cette autre scène :
La
salle de bain est moite, de partout. J'ai les pieds humides, je fais
des traces sur le carrelage. J'ai la peau qui glisse. La porte est
fermée, le miroir est embué. Je reste, là,
silencieux, dans cette petite pièce qui tombe de mes gestes.
Je fais glisser sa jupe le long de ses cuisses. Je troue des collants
qui s'emparaient de deux mollets mouillés. Je retire un
tee-shirt blanc doucement, je ne brusque rien, je soulève les
bras pour le faire passer par la tête, ses cheveux se collent à
mon cou, à ma bouche, à mes pommettes, l'odeur du
shampoing me courbe la nuque. Je lève la main, et d'un doigt,
je parcoure tout le long de la pièce, je touche les murs de la
salle de bain du bout du doigt, je veux ressentir, la matière,
le parcours de la peau. Mon doigt se courbe devant les plaques de
carrelage froid, le ciment est docile, il laisse passer, ma trace.
Arrivé à la fenêtre embuée, j'écris
son prénom, [...] , mes lettres glissent, sûres d'elles,
arrondies, penchées, [...], légèrement, sans
appuyer, la buée se laisse effacer, amoureusement, jus d'air,
esquisse du prénom.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F0%2F304957.jpg)